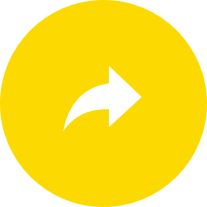Bonjour Nathalie, pouvez-vous me présenter votre parcours ?
Je suis ingénieure énergéticienne diplômée en 1997 et spécialisée en fluides et énergie. Mon parcours s’est construit entièrement en bureau d’études.
En 2003, avec Bernard Sesolis, nous avons fondé Tribu Énergie, un bureau d’études en fluides, énergie, développement durable et économie circulaire. À son départ à la retraite en 2013, j’ai repris la présidence. Aujourd’hui, nous sommes 45 collaborateurs, répartis entre Paris, Rennes et Lyon. Nous intervenons sur des projets très variés : logements, tertiaires, neuf ou rénovation, à l’échelle du bâtiment et parfois urbaine.
Attention, ne pas confondre les bureaux d’études Tribu et Tribu Énergie, car nous nous sommes séparés en 2003 et n’avons plus de lien.
Avez-vous une typologie de clients privilégiés ?
Non pas vraiment. Nous travaillons aussi bien avec des collectivités pour des équipements publics qu’avec des promoteurs sur des projets de logements ou de bureaux, mais aussi en rénovation de copropriétés.
Quel est le spectre de votre intervention ?
Nous avons plusieurs pôles d’activités.
- Un pôle assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous accompagnons les architectes, les urbanistes ou les collectivités dans la rédaction de programmes énergétiques et environnementaux, à l’échelle de bâtiments, zones urbaines ou territoires.
- Un pôle maîtrise d’oeuvre. Nous collaborons avec l’architecte dès les premières esquisses, jusqu’à la livraison, parfois même après. Cela passe par la réalisation de l’ensemble des études de maîtrise d’oeuvre : plans, CCTP pour la partie fluides, notes de calcul liées à la RE2020, simulations thermiques et environnementales, accompagnement aux certifications et démarches en économie circulaire. Le tout avec une attention constante portée à l’environnement et à la décarbonation, qu’il s’agisse d’énergie ou de matériaux, et au confort estival.
- Un pôle réglementation. Ici, nous accompagnons les pouvoirs publics sur l’élaboration des réglementations énergétiques et environnementales. Par exemple, nous avons développé la méthode de calcul DPE. Nous avons piloté les travaux du groupe modélisateurs de la RE2020.
- Un pôle formation. Nous sommes formateurs sur tous les sujets de conception et rénovation énergétique. D’ailleurs, je suis aussi enseignante à l’École des mines de Paris, aux Ponts et Chaussées, et depuis trois ans à l’École de Chaillot.
"Notre rôle, c’est d’être un pilier sur lequel l’architecte peut s’appuyer en toute confiance."
Vos journées doivent être bien remplies !
Elles sont longues, mais passionnantes et surtout bien organisées. J’ai aussi une équipe très soudée, avec une grande expérience. La moyenne d’expérience de mes collaborateurs est de onze ans.
J’imagine donc qu’intégrer des jeunes au sein de l’entreprise est un enjeu majeur, notamment pour garantir la transmission des savoirs ?
En effet, c’est un sujet clé. Je rappelle souvent à mes équipes que nous sommes avant tout des ingénieurs-conseils. Un bureau d’études apporte non seulement son savoir-faire en conception, mais aussi son expertise sur les chantiers et les audits.
C’est là que l’on comprend la faisabilité des préconisations et les difficultés rencontrées par les différents acteurs. Certains acteurs ont parfois le sentiment que des bureaux d’études se cachent derrière les chiffres. Nous, nous souhaitons être force de proposition et mettre notre expérience ainsi que notre veille innovation au service de projets durables.
Vous avez évoqué la réglementation, notamment la RE2020 et la RT2012. Certains architectes perçoivent ces règles comme des contraintes dans la conception d’un projet. Partagez-vous cet avis ?
Il est vrai qu’aujourd’hui les réglementations se multiplient à une vitesse folle : RE2020, DPE, décrets tertiaire et BACs, loi sur les énergies renouvelables, infrastructures pour véhicules électriques… Cela peut sembler complexe.
Mais toutes ces mesures ont un objectif clair : nous mener vers la décarbonation — une priorité affichée par le gouvernement depuis huit ans, et soutenue par l’Union européenne. Cette dynamique fédère l’ensemble des acteurs.
Les maîtres d’ouvrage doivent désormais faire preuve d’initiative, les industriels présentent des solutions innovantes. Les architectes sont aussi très engagés dans l’utilisation de matériaux biosourcés/géosourcés. Certaines collectivités vont encore plus loin en imposant des labels comme « bâtiment biosourcé » ou des certifications environnementales. Le fait d’intégrer ces contraintes dès l’acte de vente des parcelles permet d’éviter les contournements et, surtout, de valoriser des projets vraiment vertueux.
Rénover un bâtiment est aujourd’hui souvent vu comme le meilleur compromis. Quel est votre rôle pour ce type de projet ?
Nous intervenons dès l’audit énergétique ou global en partenariat avec des architectes pour identifier les bouquets de travaux qui permettent de combiner les enjeux : bioclimatisme, choix des matériaux, systèmes énergétiques adaptés, confort, santé, économie circulaire et maîtrise des coûts. Notre rôle est d’être un pilier au sein des équipes de conception afin de proposer des solutions qui répondent aux contraintes tout en limitant les risques.
D’ailleurs, je suis aussi sapiteure, c’est-à-dire que l’expert judiciaire me demande de l’aide sur des questions techniques qu’il ne maîtrise pas toujours (thermique, fluides…). Ce rôle me permet de mieux comprendre ce qui peut poser problème dans un bâtiment livré. Cette expérience, nous l’utilisons pour anticiper les difficultés et éviter les futurs litiges dès la conception.
Nous avons ce devoir de garantir que le bâtiment fonctionne encore dans vingt ans, surtout quand les ménages s’endettent sur plusieurs années lors d’un achat.
Le cycle de vie moyen d’un bâtiment est d’environ cinquante ans. D’après vous, que diront les concepteurs et maîtres d’oeuvre en 2075 de la production actuelle ?
Aujourd’hui, nous sommes un peu en période de rodage. De nombreuses études ont démarré avec des matériaux biosourcés, beaucoup de bois par exemple. Néanmoins, le coût pousse souvent à revenir au béton. Je ne suis pas anti-béton, parce que le béton reste indispensable, notamment pour les fondations. La filière béton a longtemps eu un monopole en France sur la construction, mais la RE2020 a poussé les cimentiers à développer des ciments moins carbonés. Il y a également de nombreuses innovations avec des matériaux biosourcés et mixtes ! Ma doctrine, c’est : le bon matériau au bon endroit. La priorité est de livrer des bâtiments durables et confortables, résilients au réchauffement climatique, avec des matériaux fabriqués le plus localement possible.
Selon vous, combien de temps va durer cette période de rodage ?
Nous avançons doucement, mais retenons que la meilleure ressource pour décarboner, c’est celle qu’on n’installe pas. Le bois, par exemple, n’est pas illimité, bien que la France gère bien ses forêts, il faut donc l’économiser pour qu’un maximum d’ouvrages puissent y avoir recours. L’avenir, c’est une approche globale de la décarbonation des bâtiments Énergie et Matériaux. Cela passe par rénover au lieu de construire, la frugalité des matériaux, les recours à des produits moins carbonés, et développer l’économie circulaire.
Parmi les leviers de la décarbonation, il y a le réemploi. Sur ce sujet, vous avez récemment travaillé sur une résidence étudiante à Saint-Ouen où vous avez utilisé des briques issues du réemploi. C’est bien ça ?
Nous avions des exigences très élevées en matière de matériaux ressourcés et de réemploi. Pour les planchers intermédiaires, nous avons utilisé des dalles mixtes bois/béton, sauf dans les salles de bains où les risques d’infiltration étaient trop
importants. Les façades, elles, sont constituées en grande partie de briques de réemploi, ainsi que d’autres matériaux réemployés. Depuis six ans, nous avons un pôle économie circulaire très actif, qui intervient dès les diagnostics PEMD/ressources.
Comment avez-vous géré la question du gisement des matériaux ?
Certains aménageurs demandent un quota important de matériaux issus du réemploi. Mais pour avoir cette ressource, il faut que les bâtiments soient déconstruits, pas démolis.
Cela implique que les maîtres d’ouvrage soient prêts à investir davantage dans la déconstruction.
C’est un vrai changement de mentalité.
Heureusement, la filière se structure rapidement, avec des plateformes spécialisées qui récupèrent, testent les matériaux, etc. Pour réussir une démarche environnementale ambitieuse, il faut garder la maîtrise d’oeuvre de l’économie circulaire de A à Z. Nous réalisons un vrai travail de recherche pour trouver des ressources alternatives si jamais la ressource locale venait à manquer.
Il existe désormais de très belles opérations pilotes : nous étions AMO énergie et environnement sur la Maison des Canaux à Paris, et le recours à des matériaux issus du réemploi a permis d’éviter 31 % de CO2 sur les émissions liées aux matériaux.
En matière de réemploi, les assureurs jouent aussi un rôle clé. Selon vous, la MAF répond-elle aux enjeux actuels ?
Je suis très attachée à la MAF. Notre métier est exigeant, parfois ingrat — surtout pour les architectes —, avec de lourdes responsabilités comme les garanties décennales. Pour bien dormir, il faut être bien assuré. La MAF répond à ces besoins, notamment pour les systèmes innovants.
Notre goût pour l’innovation implique de pouvoir compter sur un assureur qui nous fait confiance, qui prend des risques avec nous.
Ce qui m’inquiète davantage, c’est lorsque nos partenaires ne sont pas bien assurés !
"Un bâtiment détruit, ce ne sont pas que des gravats : c'est une ressource pour les futurs projets"
Si vous n’aviez pas été ingénieure, qu’auriez-vous fait ?
Bonne question ! J’ai de nombreuses passions créatives : la cuisine, la peinture sur porcelaine ou encore le feng shui à mes heures perdues, mais le bâtiment a toujours été ma passion.
Selon vous, qu’est-ce qui fait un bon ingénieur ?
La rigueur, avant tout. Nous intervenons souvent sur des garanties de performance énergétique, où on ne peut pas se permettre une erreur, même minime.
Ensuite, le pragmatisme : il faut toujours prendre du recul, car ce qui marche sur le papier ne fonctionne pas toujours sur le chantier. Enfin, la pédagogie est essentielle. Avec les nombreuses réglementations, les acteurs peuvent vite se sentir perdus.
Il faut donc parvenir à expliquer simplement tous ces enjeux sans se cacher derrière des chiffres.
Quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière ?
En tant que cheffe d’entreprise, je suis surtout fière de mon équipe qui m’étonne chaque jour par son agilité et son adhésion aux valeurs de la société.
Depuis quelques mois, nous sommes devenus une entreprise à mission pour affirmer nos engagements environnementaux.
Sur le plan sociétal, je suis présidente d’un Club des Femmes Du Bâtiment qui me tient beaucoup à cœur. Je milite donc pour promouvoir nos métiers auprès des femmes, pour les inciter à rejoindre ce secteur passionnant, en leur montrant toute la diversité des métiers.
Et côté projets, il y en a tellement… l’un d’entre eux me revient toutefois spontanément : un challenge majeur en 2011.
Bouygues Immobilier nous a confié la conception de 35 000 m² de bureaux d’énergie positive, avec garantie de performance énergétique. Je me rappelle, le directeur de Bouygues Immobilier m’avait dit : « Vous êtes déjà un bon bureau d’études, mais avec nos exigences, vous allez devenir un excellent bureau d’études. »
C’est exactement ce qui s’est passé. Ce projet nous a propulsés au sommet. Une aventure intense, mais magnifique. Après ça, tous les autres projets nous ont paru bien plus simples ! Et un coup de cœur pour la rénovation énergétique de l’aile Nord du château de Versailles qui devrait permettre 60 % d’économies de chauffage.
Merci Nathalie !