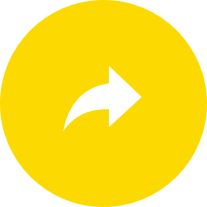Congrès Unsfa 2025 | L’IA au cœur des échanges
Le congrès de l’Unsfa 2025, qui s’est tenu à Angers, a placé l’intelligence architecturale au cœur de ses débats. Plus de 1 000 professionnels ont exploré comment l’IA transforme concrètement les pratiques des agences. Avec comme exemple, Marc Seifert, directeur de l’agence A26, qui témoigne de la façon dont l’IA lui a permis d’analyser 600 pages de documents techniques en 48 heures, impossible autrement sans mobiliser quatre personnes non-stop.
Les applications dépassent la simple génération d’images. Les agences utilisent l’IA pour structurer leurs offres, optimiser leurs simulations d’honoraires et répondre efficacement aux appels d’offres. A26 développe même des « ingénieurs prompt » en interne. L’outil représente un gain de temps substantiel dans un contexte économique tendu pour la profession.
Laure-Anne Duprez-Geoffroy, réélue présidente de l’Unsfa, appelle à définir un cadre éthique : « Ces outils s’imposent chaque jour, à nous d’en faire des alliés sans leur abandonner notre capacité à penser le sens ». L’enjeu est clair : les architectes doivent rester au cœur du dispositif créatif, l’IA ne remplace pas l’intelligence du projet architectural.
Architecture ligérienne | La relève privilégie réemploi et proximité
Organisée avec le soutien de la MAF, la cinquième édition des Jeunes architectes et paysagistes ligériens (JAPL) révèle une rupture générationnelle dans la pratique architecturale régionale. Ces professionnels de moins de 38 ans s’éloignent des projets urbains prestigieux pour investir les territoires délaissés : zones rurales, dents creuses de petites villes et friches industrielles. Claire Schorter, présidente du jury, souligne leur « maturité et leurs postures militantes en cohérence avec leurs réalisations ».
Ces architectes privilégient la réhabilitation à la construction neuve. L’Atelier du Ralliement excelle dans les extensions-réhabilitations, tandis que Socle transforme des patrimoines ordinaires, comme l’ancienne gare de Sucé-sur-Erdre. Les matériaux biosourcés et le réemploi dominent leurs projets, soutenus par des formations complémentaires en patrimoine et construction écologique.
L’ancrage local caractérise cette génération. Les agences s’installent dans d’anciennes boutiques de centre-bourg, créant des lieux d’échange avec les habitants. L’association Bientôt développe même des expérimentations sur les villes moyennes depuis Vierzon. Cette approche de « passeur-médiateur » redéfinit profondément le rôle de l’architecte contemporain.
La Grande Arche dévoilée | Jean-Louis Subileau raconte l’épopée du monument
Le nouveau film de Stéphane Demoustier « L’inconnu de la Grande Arche » (sorti en salle le 5 novembre) ravive l’histoire extraordinaire du monument emblématique de La Défense. Jean-Louis Subileau, Grand prix de l’Urbanisme 2001 et ancien directeur de la société d’économie mixte Tête Défense, démêle fiction et réalité dans cette œuvre cinématographique dédiée à l’architecte danois Johann Otto von Spreckelsen.
Basé sur le roman de Laurence Cossé, le film narre l’épopée du concours international de 1983 où 424 projets furent examinés. Johann Otto von Spreckelsen, architecte méconnu n’ayant construit que quatre églises et sa maison, le remporta avec son cube évidé, vision épurée qui séduisit François Mitterrand. L’ancien président déclara alors être « comptable de la perspective pour la Nation », soulignant l’importance historique de l’axe Le Nôtre.
Jean-Louis Subileau, incarné par Xavier Dolan sous le nom de « Subilon », rappelle les défis colossaux du projet : montage administratif complexe, cohabitation politique de 1986 et restrictions budgétaires drastiques. Face aux obstacles financiers, des solutions innovantes furent trouvées, notamment la vente par étages des parois à des compagnies d’assurance. Spreckelsen démissionna en juillet 1986, frustré par les compromis qui lui étaient imposés, et laissa Paul Andreu achever son œuvre. Il décéda en 1987 sans voir son monument inauguré pour le bicentenaire de 1989.
Architecture du futur | Comment Strasbourg imagine la mobilité sans voiture
Le projet Metamorphosis propose une vision révolutionnaire de Strasbourg pour 2100. Conçu par deux anciens cadres de l’Eurométropole et l’architecte Guy Schneider (Walden-Bio Architecture), ce masterplan ambitionne de résoudre la congestion urbaine grâce à cinq « nefs climatiques ».
Ces structures de 40 000 m² chacune filtreraient les flux automobiles aux quatre entrées cardinales de l’agglomération. Véritables pôles multiservices, elles dispenseraient les automobilistes de poursuivre vers le centre-ville. Ces infrastructures couvriraient les autoroutes, produiraient de l’énergie photovoltaïque et capteraient les particules fines selon la technologie de la start-up Terrao.
Le cinquième pôle, situé en entrée du centre-ville, se connecterait à la gare centrale par téléphérique. Ce système permettrait de rejoindre le cœur historique en 10-15 minutes à 20 km/h.
Les concepteurs visent une première concrétisation en 2040. Ils s’inspirent du concept allemand de « ville régénérative » et ont déjà été sollicités pour d’autres projets, notamment sur l’A10 près de Tours dans le cadre du programme « Autoroutes bas carbone » de Vinci.
Cette proposition a été présentée lors des Rencontres européennes de la mobilité à Strasbourg, le 13 et 14 novembre dernier.