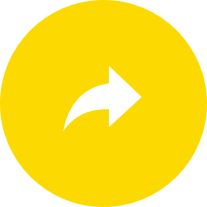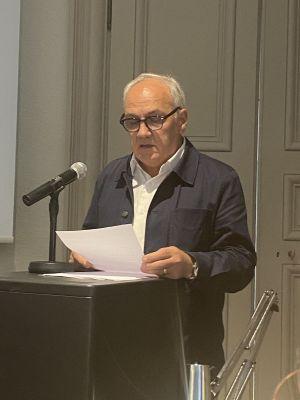
Nature et humanisme – Pour une architecture plus efficiente
Madame la Présidente de l’Académie d’architecture, chère Catherine,
Madame la Directrice de l’Architecture, chère Hélène,
Monsieur le Président du Conseil national de l’Ordre des architectes, cher Christophe,
Chères consœurs, chers confrères,
Chers amis de l’architecture,
Ce que la terre enseigne
Ces deux notions, nature et humanisme, m’ont renvoyé à de beaux souvenirs d’enfance. C’est vrai que mes premiers souvenirs d’architecture ne sont pas faits de plans ou de maquettes. Ils sont faits de poussière, de tuiles anciennes, de parpaings empilés et de week-ends passés sur un chantier. J’avais dix ans et mon père construisait notre maison, près de Montpellier. Il fallait imaginer, bâtir, composer avec les moyens du moment, trouver des outils et des matériaux déjà vécus.
Ce n’était pas encore du “réemploi” comme on l’entend aujourd’hui, mais une pratique dictée par le bon sens, le souci d’économie de moyens, les habitudes, et une certaine culture de la débrouille. Une forme d’économie attentive, presque instinctive, qui prolongeait la vie des choses.
C’était une architecture de l’attention. Une maison, en somme, construite sur l’idée que rien ne se perd et que tout mérite une seconde vie. C’est là que j’ai compris qu’un bâtiment n’est pas qu’un simple assemblage, il est un héritage vivant, une histoire qui se tisse entre les mains et le temps, qu’il ne faut pas effacer mais transmettre.
Bien plus tard, dans un petit village d’Afrique de l’Ouest, en Côte d’Ivoire, j’ai retrouvé cette même philosophie, sous une forme à la fois plus dépouillée mais adaptée au climat ivoirien.
Les maisons y étaient faites de terre. De la terre mêlée à de la paille, posée à la main, façonnée avec le geste lent de ceux qui savent que le temps est un allié. Chaque saison des pluies vient en partie les abîmer, les altérer. Et chaque année, les habitants les restaurent. Cette restauration n’est pas un simple travail d’entretien, elle est un acte de transmission, de respect des savoir-faire locaux.
Ce savoir, ce lien à la matière, cette économie circulaire avant la lettre, m’a profondément marqué. Car il ne s’agit pas seulement de techniques. Il s’agit d’une manière d’être au monde. Une manière de reconnaître que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais que nous en faisons partie.
Comme Fernand Pouillon l'avait compris en exaltant la pierre, la main de l'homme, et la continuité du geste artisanal, l’architecture n’est pas une conquête, mais une cohabitation avec le vivant. Une manière d’habiter le sol en en respectant les lois.
On le voit dans ses réalisations emblématiques, comme la cité Diar el Mahçoul à Alger, qui conjugue rationalité constructive et ancrage culturel, ou dans la reconstruction du Vieux-Port de Marseille, où la matérialité devient langage commun entre mémoire du lieu et usage contemporain.
Alors là-bas, en Côte d’Ivoire, comme dans les gestes de mon père, j’ai appris que le réemploi, la frugalité heureuse, l’ancrage local, ne sont pas des slogans. Ce sont des évidences, qui lorsque l’on devient architecte, nous habitent et nous transportent tout au long de notre vie.
Les matériaux naturels portent en eux une charge symbolique, sensorielle et philosophique qui dépasse leur seule vertu environnementale. Ils résonnent avec une mémoire profonde, presque archaïque, celle de nos premières sensations et de nos premières spéculations sur le monde, comme le rappelait Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage.
Observer la nature, y puiser nos matériaux, c'est renouer avec ce rapport instinctif et fondateur à la "première fois" : la première fois qu'on touche, qu'on ressent, qu'on comprend intuitivement ce qui nous entoure.
Des matériaux qui parlent du monde
Construire, c'est toujours se situer entre deux pôles : la nature et l'humanité. Entre le respect des ressources naturelles et la volonté de bâtir un monde pour l’homme. Cette tension féconde traverse l'histoire de l'architecture. Aujourd'hui, elle se renouvelle à travers les choix constructifs : renouer avec la nature sans renoncer à l'humanisme.
Les matériaux biosourcés et géosourcés ne sont pas neutres. Ils ont une origine, un lien avec un sol, une géographie, une économie, une culture. Ils parlent de la terre, des champs, des forêts, des rivières. Mais ils parlent aussi des femmes et des hommes qui les cultivent, qui les transforment, qui les mettent en œuvre avec des savoir-faire souvent ancestraux, parfois réinventés, toujours précieux.
Ce sont des matériaux vivants qui appellent à la patience, à l’écoute du territoire et de ses cycles, tout en ouvrant de nouvelles voies d’innovation qui servent l’humain. À l’instar des démarches portées aujourd'hui par Philippe Madec ou Dominique Gauzin-Müller, pionniers de l'architecture écologique, il s’agit d'écouter la matière, de comprendre ses rythmes et de composer avec elle.
Pendant des siècles, nous avons bâti avec ce que nous avions à portée de main. La pierre de la carrière voisine. Le bois des forêts alentours. La terre du champ d’à côté.
Puis, avec la révolution industrielle, avec la promesse de la modernité, nous avons appris à extraire, à transporter, à uniformiser, à faire toujours plus vite toujours plus grand. Le béton, l’acier, le plastique sont devenus les emblèmes d’un monde où la maîtrise technique semblait pouvoir tout résoudre, peu importe le contexte, peu importe les habitants.
Mais nous savons aujourd’hui que cette maîtrise a un coût. Et pas seulement économique. Elle a un coût écologique, un coût paysager, un coût humain, un coût social et culturel. Elle a aussi, parfois, un coût poétique. Car elle efface les liens, l’histoire de la matière, et le sens de ce qui nous entoure. Elle efface les singularités, les textures, les odeurs, les récits.
Les matériaux biosourcés et géosourcés ne sont pas des alternatives marginales. Ils ne sont pas des concessions à la mode ou à la culpabilité. Ils sont un défi à relever, une invitation à renouer avec un monde que nous avons parfois perdu de vue, tout en visant à apporter un progrès éclairé au service de l’humain. Ils sont des solutions exigeantes à des défis contemporains. Ils sont aussi une invitation à retrouver un lien. Un lien entre le bâti et le territoire. Entre l’innovation et la tradition. Entre l’architecte et l’environnement qu’il façonne.
Un humain, c’est cinq sens. C’est à eux qu’il faut parler. L’architecture n’est pas faite uniquement pour être vue ; elle doit aussi être touchée, respirée, entendue. Elle doit stimuler la totalité de notre être, renouer avec cette sensibilité globale que la modernité a parfois oubliée. Les matériaux naturels y invitent naturellement : la rugosité d’un mur de terre, l’odeur du bois, la fraîcheur d’une pierre …
La matière naturelle ne se contente pas selon moi d'habiller l’espace : elle l’anime, elle l’incarne, elle le fait ressentir. Elle convoque nos cinq sens dans une expérience pleine et instinctive. Le toucher reconnaît sa texture familière, l'odorat perçoit sa mémoire enfouie, et l’oreille, sans même y penser, s'apaise dans une acoustique douce et feutrée. Lorsque notre œil regarde cette matière alors illuminée, des sensations familières nous habitent.
Des sensations que nous avons déjà rencontrées dans la nature. Elle ne nous agresse pas l’œil, la lumière ne reflète pas trop fort et péniblement, mais, elle apaise, elle réchauffe. Grâce à des couleurs visibles et révélées depuis des millénaires, notre œil fatigué se détend. Tous nos sens sont ainsi discrètement mobilisés, dans une harmonie silencieuse qui nous relie au vivant.
Mais cette approche sensible n'exclut pas la rigueur constructive. C’est aussi tirer parti de la dualité des matériaux : prendre le meilleur de chacun pour les combiner intelligemment, en misant sur leur complémentarité plutôt que sur leur opposition. Cela ouvre des voies nouvelles à l’innovation constructive, entre technicité et sensibilité.
Et cette exigence du bon geste ne profite pas qu'aux usagers finaux. Ces choix de matériaux et de mises en œuvre améliorent également les conditions de travail sur les chantiers : moins de substances nocives, des gestes plus respectueux du corps, une relation plus saine et plus valorisante à la matière.
Aujourd’hui, les innovations constructives, qu’il s’agisse de construction hors-site, de matériaux biosourcés ou de procédés bas carbones, amplifient cette dynamique. En repensant les modes de fabrication et d’assemblage, elles contribuent à réduire la pénibilité sur les chantiers. Construire autrement, c’est donc aussi offrir aux artisans et ouvriers un environnement de travail plus humain.
Et pour les occupants, ce sont des lieux plus sains, plus respirables, plus agréables à vivre. Des espaces où l'on respire mieux, où l'on entend mieux, où la température est naturellement plus confortable. Des espaces plus agréables à vivre, plus lumineux.
Réparer plutôt que conquérir
Nous venons d’un monde qui a longtemps cru à la conquête. Conquête du sol. Conquête du confort. Conquête de la hauteur. Conquête de l’espace. Cette idée que tout était à prendre, à dominer, à transformer. Le progrès se mesurait en kilomètres de routes, en mètres carrés construits, en tours toujours plus hautes.
Mais aujourd’hui, nous savons que cette logique atteint ses limites. Le sol se raréfie. Les ressources s’épuisent. Les milieux s’effondrent. Et surtout, les modèles d’aménagement génèrent de plus en plus d’inégalités et de ruptures sociales.
Nous n’avons pas à nous flageller éternellement sur les choix passés, pris dans un contexte particulier, mais nous devons, collectivement, travailler à un avenir plus équilibré. Il ne s’agit pas pour autant de renoncer à construire, ni à faire du neuf quand cela a du sens et répond à un besoin. Il ne s’agit pas non plus de basculer dans la décroissance ou le repli. Il s’agit, bien au contraire, d’ouvrir une autre voie. Une voie de responsabilité. Une voie de réparation collective, où chaque geste compte.
Réparer, c’est revaloriser l’existant. C’est réhabiliter un bâtiment plutôt que de le raser. C’est réemployer des matériaux plutôt que d’en extraire de nouveaux. C’est dépolluer un sol pour y faire naître un jardin. C’est penser les bâtiments comme réversibles, adaptables, évolutifs. C’est remettre en question la logique de l’obsolescence programmée et construire pour durer. C’est aussi penser la ville autrement. C’est la désenclaver, l’animer, la rendre moins consommatrice, moins étalée, plus dense mais aussi plus douce.
Une ville qui réutilise ses friches, qui valorise ses marges, qui construit avec et non contre son territoire. C’est redonner enfin aux citoyens qui y vivent le droit à l’urbanité. Une voie que Roland Castro appelait de ses vœux, lui qui voyait dans la revalorisation des territoires populaires un projet politique, poétique et profondément humain.
Une prospérité réconciliée
J’aime le mot prospérité. Ce n’est pas un gros mot. Ce n’est pas synonyme de gaspillage ou d’accumulation. C’est un mot ancien. Un mot qui dit la vie qui peut s’épanouir.
La prospérité, telle que je la conçois, n’est pas incompatible avec la sobriété. Elle s’en nourrit, elle la rend possible, et elle se trouve dans un progrès éclairé et humaniste. Une prospérité durable. Juste. Ancrée. Qui s’appuie sur des matériaux locaux, sur des filières responsables, sur des emplois non délocalisables.
Les matériaux bio et géosourcés sont des moteurs de cette prospérité réconciliée. Ils nous montrent qu’on peut allier innovation technique et simplicité d’usage, qualité de vie, respect du vivant et développement économique, tout en restant au service de l’humain et de son bien-être. Ils permettent de construire mieux, plus sainement, plus intelligemment. Ils offrent du confort, de la performance, sans renoncer à la beauté ni à la poésie. Ils créent des ponts entre l’artisan et l’ingénieur, entre l’agriculteur et l’architecte, entre l’économie et l’écologie, entre la ruralité et l’urbain.
Et surtout, ils permettent de redonner du sens à notre métier. Car au fond, construire, c’est quoi ? C’est rendre possible l’habitation du monde. C’est permettre à chacun de trouver sa place. C’est donner une forme à l’avenir, pour que chaque génération puisse s’y inscrire, dans un respect profond de l’humain et de ses besoins. C’est relier des vies, des usages, des saisons, des climats. C’est travailler à la fois pour aujourd’hui, pour demain, pour les générations futures.
Anticiper les risques pour s’en libérer
Construire, c’est aussi toujours prendre un risque. Celui de mal faire, de ne pas durer, de ne pas répondre. Mais c’est aussi le risque d’innover, d’imaginer autrement, de chercher des voies nouvelles.
Face à ces risques, la tentation est grande de se replier : sur des certitudes, des modèles figés, des matériaux standardisés. Mais l’architecture ne peut pas être seulement une gestion de la conformité. Elle est aussi, profondément, une aventure de pensée et de forme. C’est une aventure qui doit savoir se sécuriser tout en restant audacieuse, innovante. Et pour qu’elle le reste, il faut apprendre à sécuriser l’audace.
Anticiper les risques, c’est les regarder en face, les analyser, les discuter. C’est transformer l’incertitude en opportunité. C’est s’outiller, collectivement, pour transformer l’incertitude en connaissance. C’est faire de la rigueur un levier de liberté.
C’est aussi une manière d’assumer la responsabilité de construire. Non comme une charge paralysante, mais comme une exigence éthique. Celle de respecter le vivant, de ménager le territoire, de vivre le temps long. Celle de transmettre un cadre bâti qui ne soit pas une dette, mais un patrimoine partagé.
Il existe des alliés pour cela. Des partenaires - dont la Mutuelle que je préside, fait partie - qui permettent à l’architecture de rester ancrée tout en l’encourageant à explorer de nouvelles voies. Des partenaires discrets mais essentiels, qui permettent à l’architecture d’explorer sans crainte. Grâce à eux, la créativité ne flotte pas : elle s’ancre, elle s’assume, elle devient force.
Continuer à habiter le monde
Chères consœurs, chers confrères, chers amis de l’architecture, c’est un honneur profond que d’être accueilli aujourd’hui à l’Académie d’architecture. Un honneur, et une responsabilité. Car cette institution est un lieu de savoir, de débat, de transmission. Un lieu où l’on interroge autant qu’on affirme. Où l’on écoute autant qu’on enseigne.
J’y vois un appel à continuer. Continuer à construire, bien sûr. Mais aussi continuer à chercher, à douter, à expérimenter. Continuer à être des architectes du monde, qui habitent avec soin, avec conscience, avec espoir.
Les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi sont les matériaux d’un avenir possible. Non pas d’un avenir de renoncement, mais d’un avenir de réconciliation. Réconciliation entre l’homme et son milieu. Réconciliation entre le confort et la responsabilité. Réconciliation entre le progrès et la nature. Réconciliation entre la nature et l’humain.
Ce ne sont pas des matériaux de substitution. Ce sont des matériaux de réinvention, porteurs d’une nouvelle architecture, plus humaine, une architecture de proximité en quelque sorte. Ce sont les matériaux de l’intelligence collective, de l’innovation respectueuse, du progrès habitable. Ce sont les matériaux d’un monde que nous devons habiter, ensemble.
Merci.
Sur le même sujet
15 décembre 2025