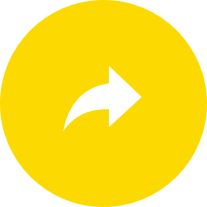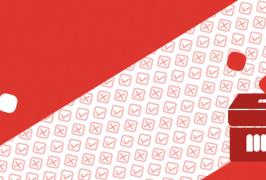Lutte contre l’étalement urbain, protection de la ressource, baisse des émissions de CO2… les travaux sur ouvrages existants ont désormais le vent en poupe dans une économie qui se veut sobre. Pour relever ce défi, le patrimoine bâti constitue un formidable gisement d’opportunités pour les architectes. Ces mutations de constructions existantes passent en premier lieu par la maîtrise des règles d’urbanisme qui peuvent réserver quelques surprises.
Ainsi, rappelons que si les règles qui s’appliquent aux travaux neufs sont plus exigeantes que celles pour les travaux sur existants, ces derniers peuvent être soumis dans certains cas à déclaration préalable ou permis de construire comme des constructions neuves. Mais qu’entend-on au juste par travaux sur une « construction existante » ? Le code de l’urbanisme ne donne pas de définition précise1.
La jurisprudence apporte toutefois un éclairage en précisant qu’elle n’est pas une ruine. Cette dernière ne peut donner lieu qu’à des travaux de reconstruction assimilables à des constructions nouvelles, lesquelles ne bénéficient pas des règles propres aux constructions existantes.
CONSTRUCTION EXISTANTE OU RUINE
Ainsi, les travaux sur une construction existante portent sur un bâti ancien qui a conservé l’essentiel de son gros oeuvre et de sa toiture. C’est le cas par exemple d’un immeuble construit au XIXe siècle, n’ayant plus de menuiseries extérieures et de plancher au premier étage, mais ayant conservé la totalité de son gros oeuvre, sa toiture et ses murs extérieurs2.
C’est également le cas d’un immeuble comportant ses murs porteurs, ses façades et un rez-de-chaussée en bon état, mais ayant un premier étage en partie délabré et ayant perdu une partie de la toiture, ces derniers ayant été démolis à la suite d’un permis de démolir3.
En revanche, sont considérés comme une construction nouvelle les travaux de réhabilitation ou reconstruction portant sur une construction qui n’a par exemple conservé que ses murs, ou dont la démolition totale était inévitable. C’est le cas d’un restaurant de plage ayant subi d’importantes destructions à l’occasion d’un attentat par explosif, entraînant notamment la disparition de la toiture, du plancher, du premier niveau, des menuiseries extérieures et de divers aménagements extérieurs, seuls les murs ayant été épargnés4 ; c’est également le cas d’une maison d’habitation, consécutivement à la dépose d’une toiture ancienne ayant, pour des raisons techniques, rendu nécessaire la démolition totale du bâtiment existant5.
CONSTRUCTION NOUVELLE OU EXTENSION
Cette distinction est déterminante pour la prise en compte des règles d’urbanisme applicables au projet. C’est également le cas entre une « construction nouvelle » et une « extension ». Dans la mesure où elle n’a qu’un impact limité sur les paysages, l’extension fait l’objet de règles d’urbanisme plus favorables que celles régissant les constructions nouvelles. Cette faculté de prévoir des règles différenciées entre construction nouvelle et extension d’une construction existante est d’ailleurs implicitement encouragée par les dispositions du code de l’urbanisme6.
Il convient là aussi de porter une attention particulière à la qualification des travaux projetés. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
La caractéristique essentielle de l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Le lexique national d’urbanisme le précise ainsi : « sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante.
Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) »7. A défaut, le projet relève de la réglementation d’urbanisme applicable aux constructions nouvelles.
Les trois critères du régimes aux extensions
1. La présence sur le terrain d’une construction existante.
À noter que l’agrandissement d’une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, n’ayant pas d’existence juridique, nécessitera une autorisation portant sur la construction existante et son extension, à l’aune des règles applicables aux constructions nouvelles.
2. Une continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante, dont l’extension constitue le prolongement.
La création d’une piscine sur une parcelle attenante à celle sur laquelle se situe la construction existante ne constitue pas une extension.
3. L’impossibilité d’assimiler l’agrandissement à un nouveau projet en raison de son importance par rapport à la construction existante.
Sous réserve que le PLU ne retienne pas une définition spécifique de l’extension en fixant un seuil de surface, le juge fait une application assez souple de ce critère.
Pour en savoir plus…
- Dans votre espace adhérent : Boîte à outils permis de construire (BOPC) de la MAF.
- Chapitre 9 « Typologie des autorisations d’urbanisme » aux paragraphes suivants :
- 9.1.4 Quelle est la distinction entre une construction nouvelle et une extension ?
- 9.8.1 Qu’entend-on par « travaux sur une construction existante » ?
- Sous-chapitre 9.3 « Quelle autorisation lorsqu’on construit ? » pour réviser les règles d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles et celles applicables aux constructions existantes.
1. Voir le lexique national d’urbanisme qui apporte toutefois cette définition : « Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. »
2. CAA de Marseille, 10/12/1998, n° 97MA00527.
3. CAA de Marseille, 29/01/2004, n° 01MA01063.
4. CAA de Marseille, 30/03/2006, n° 03MA01362.
5. CE, 10/05/1995, n° 130369.
6. Article R. 151-2 du code de l’urbanisme.
7. Voir le lexique national d’urbanisme.